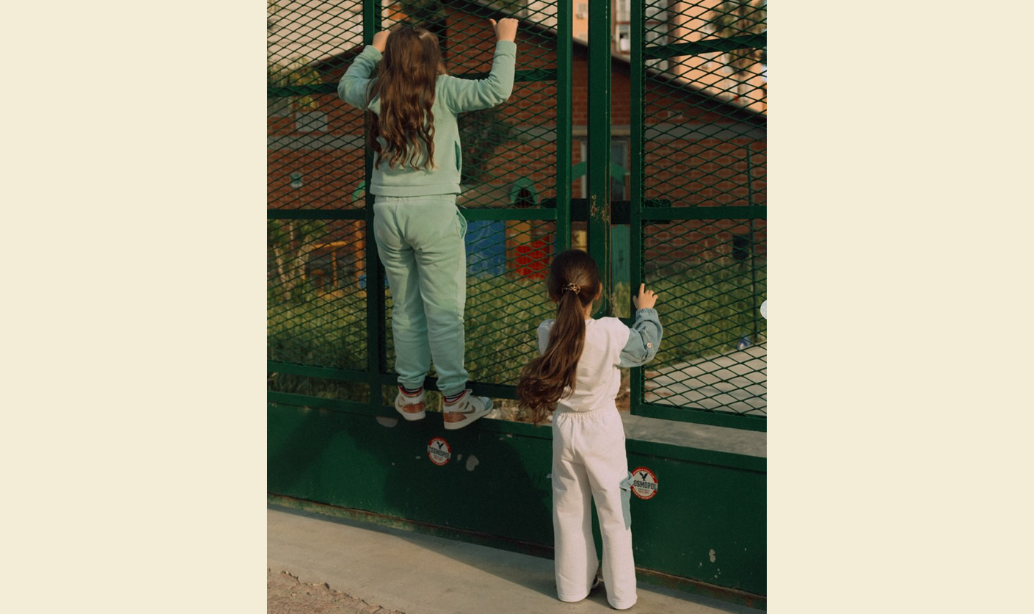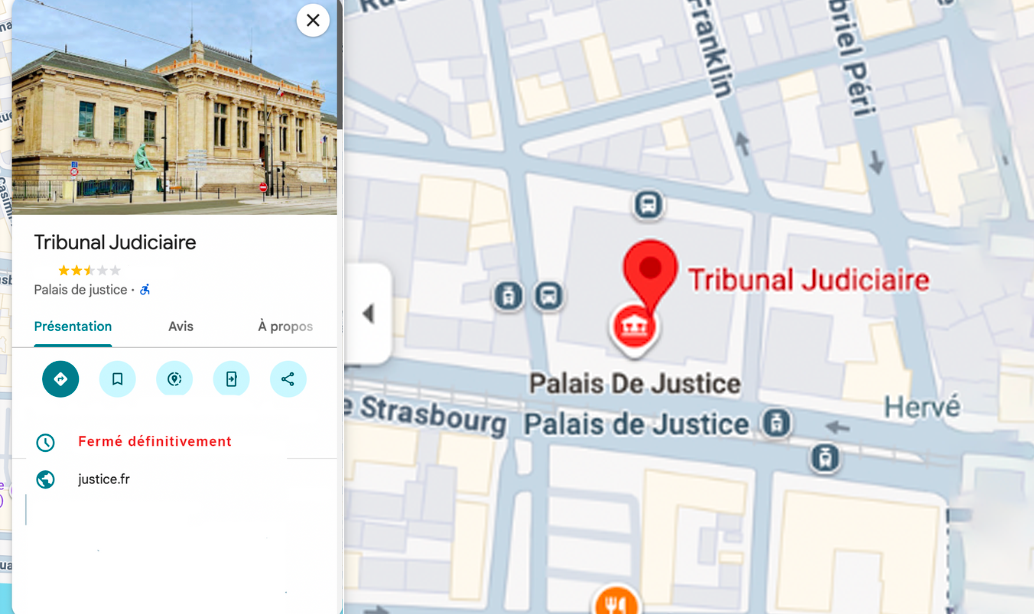Le Tour de France, cette course mythique suivie mondialement, dispose d’une renommée particulière. Ce qui n’est pas sans incidence juridiquement…Mais, qu’en serait-il si le Tour n’était qu’une course parmi d’autres ? Avec la rubrique Uchronique, 90° réinvente l’histoire.
Une marque de renommée éclaboussée
Ce n’est pas la Grande Boucle qui était dans le viseur de la Cour de cassation le 19 mars 2025, mais une course aux contours bien moins escarpés : le “Tour de France à la rame”, une affaire où se croisent prouesse sportive et droit des marques.
En cause, l’utilisation du nom “Tour de France” par cette course nautique. Une utilisation jugée problématique par les organisateurs du célèbre événement cycliste, qui invoquent une atteinte à leur marque de renommée. Car oui, juridiquement, le Tour de France, ce n’est pas qu’un événement sportif, c’est aussi une marque. Et pas n’importe laquelle : une marque de renommée, protégée au-delà des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.
Sans cette protection renforcée, le “Tour de France à la rame” aurait peut-être pu coulé des jours tranquilles… Mais la renommée, comme la mer, ne se partage pas sans vague.
Les signes distinctifs en selle
Dans cette affaire, la question était de savoir si la dénomination “Tour de France à la rame” portait atteinte à la marque « Tour de France », enregistrée par ASO (Amaury Sport Organisation) pour une large gamme de services, dont l’organisation d’épreuves sportives (classe 41).
La Cour rappelle le principe fondamental issu de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (ancienne rédaction) : une marque de renommée bénéficie d’une protection même au-delà des produits ou services désignés, dès lors que l’usage d’un signe similaire permet de tirer profit indûment de sa notoriété ou d’en altérer l’image. C’est ce lien — même indirect — entre les deux signes qui fonde la protection.
Ici, l’ajout de l’expression “à la rame” ne suffisait pas à faire oublier l’essentiel : la captation d’une image, d’un héritage symbolique. En somme, une tentative de drafting juridique derrière un peloton célèbre.
Une renommée tout terrain ?
La Cour de cassation n’a pas laissé passer cette échappée. En se fondant sur la jurisprudence Intel de la CJUE (C-252/07), elle rappelle que certaines marques jouissent d’une renommée d’une intensité telle qu’elle dépasse largement leur public d’origine. C’est le cas du Tour de France, qualifié de « troisième événement sportif mondial », dont le taux de notoriété dépasse 90 % dans plusieurs pays.
Pour bénéficier de cette protection étendue, encore faut-il démontrer la renommée au sens juridique du terme : une connaissance par une partie significative du public concerné, une image forte construite dans la durée, et un caractère distinctif élevé. Trois cols de catégorie spéciale pour accéder au maillot jaune de la protection juridique.
Le “Tour de France”, en tant que marque, coche toutes les cases. De ce fait, elle bénéficie d’une position qui lui permet de repousser les tentatives de parasitisme, même venues des canaux alternatifs. Risque de dilution, atteinte à l’image, ou simple évocation opportuniste : autant de pièges sur la route du droit illustré par cette affaire.
Dès lors, même si le “Tour de France à la rame” relevait d’une discipline différente et exploitait d’autres services, l’usage de cette dénomination présentait un risque de brouillage. La Cour souligne que la cour d’appel n’a pas recherché si cette utilisation pouvait affaiblir le rattachement symbolique du public à la marque “Tour de France”, en la banalisant, voire en la faisant percevoir comme un terme générique. C’est précisément ce glissement sémantique, redouté par les titulaires de marques de renommée, que le droit cherche à éviter.
Changement de braquet
Et si, dans une autre histoire, le “Tour de France” n’avait pas été aussi célèbre ? Si son nom n’évoquait rien d’autre qu’un vague circuit départemental ? La décision aurait-elle été la même ? Probablement pas.
Car ici, sans la reconnaissance de la renommée, les signes n’étaient ni identiques, ni appliqués à des services strictement similaires. C’est donc bien le statut renforcé de la marque qui a permis à ASO de s’opposer efficacement à l’initiative nautique. Un exemple éloquent de l’importance stratégique de la renommée dans le droit des marques — et un rappel que, dans la course à la protection juridique, mieux vaut partir en tête avec un bon capital de notoriété… et avec les bons conseils !