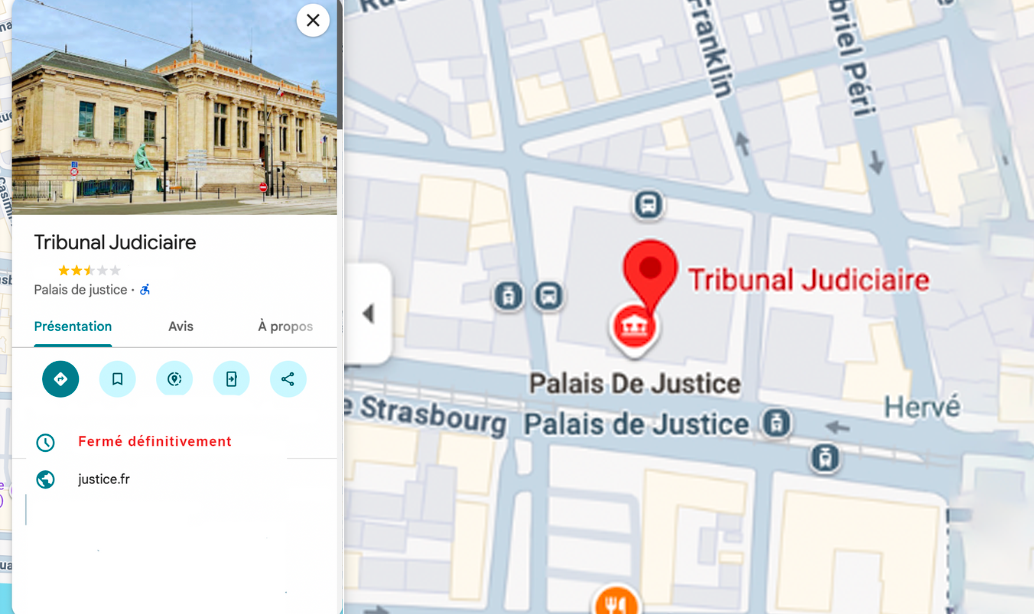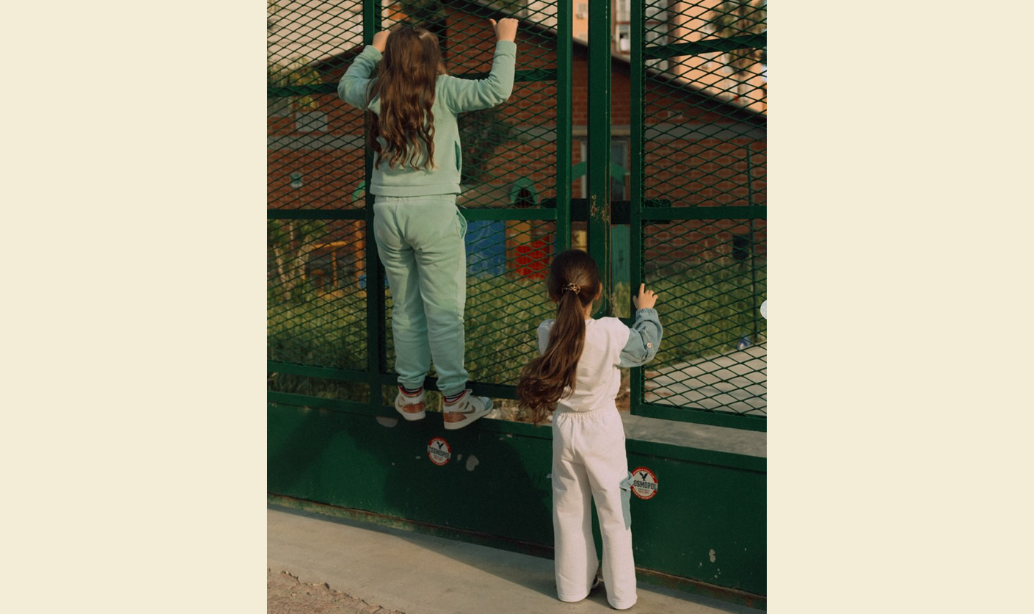Afflux massif de litiges, manque de moyens, dysfonctionnements (lenteur chronique, pénurie de ressources) : la tension pèse sur le système judiciaire actuel. Dans ce contexte, les modes alternatifs de résolution des différends (MARD) – déjà assez répandus chez les anglosaxons – se présentent comme une alternative de plus en plus plébiscitée.
En effet, la politique judiciaire récente incite de façon exponentielle les justiciables à recourir à des modes conventionnels de règlement (c’est-à-dire en « pactisant de gré à gré ») de leurs différends. Par exemple, depuis octobre 2023, le recours amiable préalable à la saisine judiciaire est devenu obligatoire pour les plus petits litiges, inférieurs à 5000 €.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre dernier, poursuit cette politique et invite les parties à contractualiser la phase d’instruction de leurs litiges outre l’introduction d’une amende civile en cas de refus pour les parties de se plier à l’injonction du juge de rencontrer un médiateur.
Ce contexte législatif et réglementaire pousse à l’imagination : que se passerait-il si l’Etat abandonnait définitivement tout pouvoir judiciaire régalien au profit d’une seule justice privée ?
Projetons-nous dans un 2083 fictif où les tribunaux auraient disparu.
La genèse d’un monde sans tribunaux
Bienvenue en 2083. La justice française a subi une transformation radicale : tous les tribunaux étatiques ont été fermés.
Poussant à son paroxysme l’idée selon laquelle la justice civile est l’affaire des parties et que les MARD constituent autant de solutions plus rapides, plus flexibles et plus collaboratifs, les pouvoirs publics ont décidé de supprimer les tribunaux.
Les juges ont été remplacés par des acteurs privés : médiateurs, conciliateurs et arbitres. Hors du cadre judiciaire traditionnel, la société a décidé de privilégier des solutions basées sur le dialogue et la collaboration, au nom de la préservation des relations entre les parties.
Le système de médiation et d’arbitrage privé
Cette culture de l’amiable s’est répandue et a fait son chemin dans les milieux économiques.
L’Etat se félicite d’un monde où les parties collaborent à la résolution de leur différend de façon sereine et efficace. Il évoque un nouvel ordre social, un changement de paradigme sociétal profond avec à son cœur dialogue et co-construction des solutions plutôt que coercition. Les MARD permettent notamment de faire émerger les sujets sous-jacents de conflits, auxquels on donnait jusque-là peu de valeur. Ressentis, non-dits, motivations profondes ne trouvaient pas leur place dans des procédures judiciaires classiques. Or ces derniers mettaient de l’eau au moulin des conflits. Grâce au travail de maïeutique permis par les MARD, on voit des résolutions émerger à des vitesses record, des cas bloqués depuis des années se dénouer en quelques séances de médiation, par la force du dialogue. L’État prône un processus rapide, flexible… et qui permet de réduire à un minimum historique le budget de la Justice.
Les grandes entreprises sont, elles aussi, de fervents défenseurs de ces modes de règlement. Les discussions sont orchestrées par des médiateurs professionnels évoluant dans des cabinets privés et indépendants. Leur rôle est in fine de trancher entre les parties, en favorisant un dialogue constructif pour aboutir à un compromis satisfaisant. Issus du même monde que les parties, ils sont formés dans des domaines spécifiques (litiges commerciaux, fusions acquisitions, violations de propriété intellectuelle). Cette double expertise leur offre une meilleure compréhension du contexte général du conflit et des mécaniques sectorielles, et ainsi plus de créativité dans les solutions à proposer.
Le meilleur des mondes ?
Mais dès les premières années de l’application de ce modèle, plusieurs écueils voient le jour. Incapacité des parties à s’accorder sur un médiateur ou sur les contours de la médiation, non-application des termes des accords : les cas de dénis de justice se multiplient rapidement. Devant le nombre exponentiel d’affaires restées dans l’impasse, les pouvoirs publics renforcent le cadre des MARD. Dès 2086, les parties confrontées à un différend sont désormais contraintes de s’accorder sur le nom d’un médiateur, de suivre la procédure de médiation et, à son terme, de trouver un accord.
Pour permettre des échanges de bonne foi, le coût de ces intermédiaires est depuis toujours divisé à parts égales entre les deux parties. Dans ce système privé des médiateurs, l’État décide d’encadrer les honoraires après quelques années marquées par l’inflation des prix. Malgré tout, le coût de la médiation pèse sur certains petits acteurs économiques, qui, triplement plombés par les effets du contentieux, des frais liés à leur règlement, et du temps qu’ils doivent y consacrer, se retrouvent dans des difficultés financières les conduisant jusqu’à la faillite. Le temps de médiation devient proportionnel à la capacité financière des parties.
Et ceci peut poser problème. Comment trouver une résolution co-construite quand le temps de dialogue possible est trop court ? Les petits acteurs se trouvent parfois contraints d’accepter des solutions déséquilibrées (faute de recours possible à un juge). La résolution, loin de l’idéal de départ, prend des allures de « la moins pire des solutions ». Dès lors, « temps et argent » remplacent progressivement « consentement et bonne foi » comme garants du succès des MARD. Au final, les parties se retrouvent contraintes à mettre en œuvre des décisions jugées au mieux bancales, au pire injustes.
En 2090, face à une crise de confiance majeure du système « idéal », les professionnels du droit et les pouvoirs publics lancent de grands travaux pour faire évoluer les MARD. Dans les discussions, la création émerge d’une entité indépendante, accessible à tous, éthique, non contrainte par le temps, gardienne des principes fondamentaux du droit, et qui offre des voies de sortie des conflits – même quand le dialogue est rompu. Une entité aux allures des tribunaux des années 2020 ?